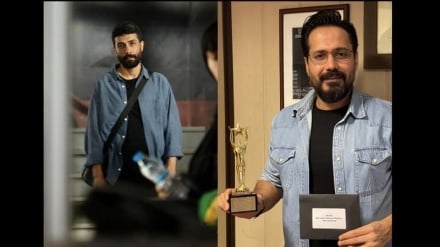Troisième voyage : en route pour Ispahan
Ispahan, surnommée « la moitié du monde », n’est pas seulement l’une des plus belles villes d’Iran, mais aussi l’un des centres historiques et culturels les plus importants du monde.
Notre voyage commença à Suse, l’ancienne capitale des Élamites, vieille de plusieurs millénaires. En chemin, nous atteignîmes Chiraz, un fragment de paradis terrestre niché au cœur des monts Zagros. Chiraz, berceau de poètes tels que Hafez (1315–1390) et Saadi (1209–1291), nous envoûta avec sa mosquée colorée, le mausolée de Shah Cheragh (AS) (frère de l’Imam Reza (AS)), ses jardins paradisiaques et l’école où Shahab-e Din Suhrawardi (1154–1214) enseignait la « Sagesse Illuminative » — une fusion de l’islam et de la philosophie persane antique.
Chiraz nous ensorcela aussi avec son Bazar-e Vakil, ses montagnes sacrées, ses mystiques, de Ruzbehan Shirazi (1128–1210) à Vahshi Bafqi (1533–1583), et ses jasmins amoureux — gardiens des traditions chevaleresques de l’Iran antique.
Mais en quittant cette ville que Hafez nomma « Chiraz la Bienheureuse », notre regard se tourna soudain vers Pasargades, ses chérubins et ses colonnes majestueuses taillées dans la pierre et ornées de bas-reliefs de soldats achéménides — témoins silencieux d’un empire qui fut un temps « le premier empire où le soleil ne se couchait jamais ».
Sur la Route achéménide : De Naqsh-e Rostam à Firouzabad
L’antique route de Chiraz à Ispahan nous plongea au cœur d’empires successifs. Nous visitâmes "Naqsh-e Rostam", où les tombes rupestres des Achéménides (Darius Iᵉʳ et Xerxès) veillent en silence au sommet des falaises. « Plus bas, les Sassanides gravèrent leurs victoires sur Rome ; ils se savaient les héritiers des Kayanides. »
À Firouzabad, la ville circulaire d’Ardashir Babakan(règne 224–242 ap. J.-C.) — semblable à un mandala antique — résiste encore aux forces de la nature. Inspirée par la vision cosmique des héritiers achéménides, cette ville célébrait la souveraineté divine sur le ciel et la terre. Mais au fond, quelle différence entre Ahura Mazda de Zoroastre (628–551 av. J.-C.) et Allah de Mohammad (570–632 ap. J.-C.) ?
En franchissant les portes de la ville, nous nous souvînmes d’un hadith du Prophète (paix sur lui) : « Je suis la Cité du Savoir, et Ali en est la porte. » L’Iran a montré que son âme accueille les métamorphoses à bras ouverts : du changement de nom de Rouzbeh le Zoroastrien (VIᵉ siècle) à Salman le Perse (568–653), il ne fallut qu’un pas pour que Salman soit considéré comme un proche du Prophète. L’Iran a enseigné au monde qu’il n’y a pas de frontière entre progrès extérieur et intérieur. Cette terre est le berceau de saints et de rois préislamiques immortalisés par Ferdowsi (940–1020) dans le Shâhnâmeh (Le Livre des Rois)
Pasargades : Symbole de la Pensée Libre de l’Iran Antique
Sur la route d’Ispahan, un panneau « Siwand » nous dirigea vers les pierres inachevées de Persépolis, où subsistent les traces des outils des ouvriers achéménides — et leurs noms sur des tablettes pour défendre leurs droits. Cyrus le Grand (559–530 av. J.-C.) instaura cette noble tradition. À Pasargades, son tombeau simple mais majestueux s’élève sous un ciel d’azur. « Les Mongols ou même Alexandre le Grand (356–323 av. J.-C.) oseraient-ils troubler le repos de l’homme qui marcha avec Dieu et déclara : "J’ai accordé la liberté au peuple ? »
Ispahan, Joyau du Monde
Enfin, nous atteignîmes Ispahan— « la Moitié du Monde » — et la Place Naghsh-e Jahan. Plus qu’une place, c’est une scène où les Safavides mêlèrent art, pouvoir et foi.
Le dôme de la Mosquée Cheikh Lotfollah passe de l’or au turquoise sous le soleil, et le Palais Ali Qapu, avec ses salles de musique, semble encore résonner du son du - « ney » et du « daf ».
Ali Qapu et l’Herméneutique du « Khalija »
Dans son livre L'Islam iranien (1971–1973), l’orientaliste français Henry Corbin (1903–1978) considère les cavités acoustiques du palais d'Ali Qapu comme une représentation du « Khâlija » (le vide médian). Selon Corbin — qui a étudié la mystique chiite pendant vingt ans — ce « vide » relie la matière et le sens. La flûte de roseau de Mowlânâ Jalâl al-Dîn Rûmî (604–672 H), qui commence son Masnavi spirituel par "Écoute la flûte de roseau", symbolise cette conception de l’« anéantissement de soi » à travers le détachement de l’ego.
Histoire d’Ispahan
Ispahan joua un rôle clé à travers les âges. Sous les Sassanides (IIIᵉ–VIIᵉ siècle), nommée « Spahan », c’était une ville stratégique et fertile. Son apogée survint sous les Safavides (1501–1722), notamment sous « Shah Abbas Iᵉʳ » (1571–1629), qui en fit sa capitale en 1598. Il construisit la Place Naghsh-e Jahan (1602), la Mosquée Sheikh Lotfollah (1603–1619), le Palais Ali Qapu (XVIIᵉ siècle) et les ponts du Zayandeh Rud (comme le « Pont Khaju » , (1650), transformant Ispahan en un centre culturel et commercial attirant même les Européens.
Après la chute des Safavides accélérée par l’invasion afghane (1722), Ispahan perdit sa splendeur, mais renaît sous les Qajars (1794–1925) comme centre provincial. Sous les Pahlavis (1925–1979), l’industrie et la modernité côtoyèrent la tradition. Aujourd’hui, Ispahan brille comme un joyau du patrimoine iranien.
Devant la Porte Nord de la Place Naghsh-e Jahan
En flânant dans les ruelles le long du Zayandeh Rud et en traversant le pont Khajou (1650), nous sommes arrivés sur la place Naqsh-e Jahan. La porte nord, majestueuse et silencieuse, se dresse sur ses bases métalliques tel un gardien. « C'est ici qu'en 1722, Mahmoud Hotaki, ou Mahmoud Afghan, avec son armée (1697–1725), assiégea Ispahan, provoquant ainsi la chute des Safavides. »
Ali Qapu, le bazar, la mosquée des femmes, la mosquée du vendredi : cité idéale ou ville-monde ?
En franchissant la porte, la place s’ouvre comme une toile vivante. À droite, Ali Qapu (XVIIᵉ siècle) se dresse avec son iwan élevé, où résonne encore la musique safavide. Ses fenêtres ajourées et ses fresques évoquent les parties de polo des rois.
Puis le Bazar historique, où les caravansérails animés cèdent place à des cafés parfumés au café et au safran, sur fond de soie et de marqueterie.
Mosquée Cheikh Lotfollah : Architecture de Lumière et de Mystère
Face à la Mosquée Cheikh Lotfollah" (1603–1619), son dôme gris-bleu s’illumine de motifs islamiques. « Cette mosquée était réservée aux dames de la cour. Cheikh Lotfollah creusa un tunnel jusqu’à Ali Qapu pour qu’elles prient à l’abri des regards indiscrets. » Au bout d’un couloir sombre et sinueux, une lumière en forme de queue de paon éclaire le mihrab. « À midi, cette lumière indique la qibla. Cheikh nous glasse à l'oreille : « Après les ténèbres du monde, la lumière divine nous attend. »
-Sheikh Baha’i (1547–1621) et les Qanats Sauveurs
Avant d’atteindre la Mosquée du Vendredi, nous pensâmes à Sheikh Baha’i : « Ce savant safavide conçut les qanats d’Ispahan pour qu’ils acheminent l’eau des montagnes servant également de refuge lors des invasions mongoles (XIIIᵉ siècle). »
Mosquée du Vendredi
Au bout de la place, la Mosquée du Vendredi d’Ispahan (construite en 771, agrandie sous les Seldjoukides, XIᵉ–XIIᵉ siècle) s’élève ; ses vastes cours témoignent de huit siècles d’histoire. « L’inclinaison de son dôme vers La Mecque n’est pas une erreur, mais un calcul astronomique précis. Cette "imperfection apparente" révèle le génie de nos ancêtres. »
En somme, la Place Naghsh-e Jahan n’est pas qu’un ensemble architectural ; c’est un récit de résilience, de mysticisme et d’art, nous appelant des ténèbres vers la lumière.
D’une cité sassanide (IIIᵉ–VIIᵉ siècle) à la brillante capitale des Safavides (XVIᵉ–XVIIIᵉ siècle), Ispahan a toujours été le cœur battant de la culture iranienne. Son héritage architectural, ses épreuves historiques et ses renaissances reflètent les alléas et le tumulte de l’Iran. Comme Hafez le chanta : « Le monde est un miroir, et Ispahan en est la plus belle image ».