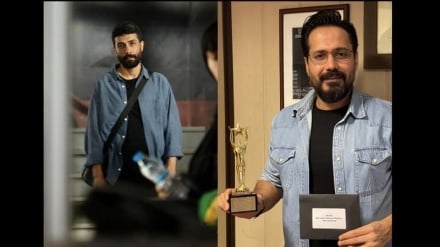Quatrième voyage : aux portes de Hamadan
Connue autrefois sous le nom d’Hagmatana, la ville de Hamedan a été le centre du royaume des Mèdes et abrite aujourd’hui de nombreux sites historiques, dont la colline d’Hegmataneh, le mausolée d’Avicenne et celui de Baba Taher.
Le voyageur qui pose pour la première fois le pied sur les terres verdoyantes et montagneuses de Hamadan découvre, sur ce sol, les empreintes éparses de l’histoire. Dans la vaste plaine reliant la ville à la vallée fertile de Ganj Nameh, les inscriptions de Darius Iᵉʳ et de son fils Xerxès surplombent une rivière ancestrale. Non loin, les tentes noires des nomades rappellent une coexistence millénaire entre peuples sédentaires et nomades. Si le voyageur accepte leur hospitalité et goûte au doogh-e mashk – cette boisson à base de yaourt fermenté, aigre et pétillant –, l’expérience restera à jamais gravée dans sa mémoire. Pour ses habitants, Hamadan évoque le qeymar matinal (crème fraîche dans des bols en céramique bleue) acheté chez « Davoudj Ali », le pain lavash fin de la vallée de Moradbeig, ou les hivers glacés passés sous le korsi (table chauffante) près de la vieille radio du grand-père. Sortir des sentiers battus et des clichés stéréotypés constitue alors le premier pas vers la découverte de Hamadan, afin d’embrasser ses us transmis oralement : dormir à la belle étoile sur le balcon, déblayer la neige des toits avant la nuit, briser la glace des bassins pour les ablutions à l’aube. Ces rituels ne sont pas des légendes, mais un mode de vie aujourd’hui menacé par la modernité.
La province de Hamadan
Région montagneuse de l’ouest iranien, la province de Hamadan est bordée au nord par Zanjan, à l’est par Markazi, au sud par le Lorestan et à l’ouest par Kermanshah. Son chef-lieu éponyme, niché à 1 890 mètres d’altitude au pied du mont Alvand, se trouve à 337 kilomètres de Téhéran. Son climat alterne hivers rigoureux et étés tempérés, tandis que ses coordonnées géographiques (34°48′ N, 48°29′ E) en font un carrefour stratégique entre les plaines centrales et les contreforts du Zagros. Autour de la ville s’étend un réseau de districts historiques : Malayer, Nahavand et Tuyserkan.
Hamadan : un contexte touristico-historique particulier
Berceau de civilisations, mais éclipsée par Ispahan pour ses monuments spectaculaires, Hamadan révèle son passé à travers ses alentours. À Nahavand, la légende attribue à Noé la fondation de la ville. Kangavar, situé à mi-chemin entre Hamadan et Kermanshah, conserve les vestiges du temple d’Anahita, déesse des eaux vénérée dans l’Iran préislamique. Mais son joyau incontesté demeure les inscriptions de Ganj Nameh : gravées sous Darius Ier (522–486 av. J.-C.) et Xerxès (486–465 av. J.-C.), ces textes trilingues — en vieux perse, élamite et babylonien — célèbrent leurs victoires et rendent grâce à Ahura Mazda. « Ahura Mazda, grand Dieu, créa cette terre, le ciel et l’humanité… », proclame Darius. Xerxès y ajoute une leçon morale : « Par la volonté divine, je maintins l’ordre et combattis le Mensonge. » Ces mots, bien plus qu’un hymne triomphal, trahissent les craintes des Achéménides : sécheresses, révoltes, fléaux menaçant leur héritage.
Hamadan entre mythes et leçons morales : l’exemple de Jamshid
Dans le Shahnameh, ou Livre des Rois (épopée du Xe siècle), Ferdowsi raconte la chute de Jamshid, roi légendaire qui enseigna aux hommes la métallurgie et instaura le Nowruz, le nouvel an persan. Son orgueil — s’être prétendu l’égal des dieux — lui fit perdre le farr-e izadi, cette « lumière divine » symbolisée par un oiseau planant au-dessus des souverains justes. Son destin illustre un thème central de la culture persane : l’hybris — ou la démesure — précipite la ruine. Des inscriptions de Cyrus aux quatrains de Rûmî, l’Iran antique rappelle que l’humilité et le respect de la nature fondent les civilisations durables — une leçon qui résonne étrangement dans notre société dite « civilisée ».
La transition des Mèdes aux Achéménides : mythes, trahisons et continuité
Au VIᵉ siècle av. J.-C., les Mèdes régnaient depuis Ecbatane (Hamadan), cité fortifiée par sept remparts concentriques symbolisant l’unité de leurs tribus. Leur dernier roi, Astyage (585–550 av. J.-C.), est dépeint par Hérodote comme un souverain tyrannique, obsédé par une prophétie : son petit-fils Cyrus, né de sa fille Mandane et d’un vassal perse, finirait par le renverser.
Après une tentative avortée d’assassinat, Cyrus, élevé en secret, mena une révolte soutenue par des généraux mèdes, dont Harpage. En 550 av. J.-C., la bataille de Pasargades scella le destin d’Astyage, capturé mais épargné, conformément à la tradition perse de clémence.
Les sources divergent : pour Ctésias, Cyrus n’était qu’un simple soldat, sans lien familial avec Astyage. La Chronique de Nabonide — texte babylonien — évoque un coup d’État rapide, sans guerre majeure. Les inscriptions achéménides, quant à elles, passent sous silence les Mèdes, effaçant toute légitimité dynastique antérieure. Pourtant, l’archéologie révèle une continuité frappante : à Ecbatane, aucune trace de destruction massive ne marque cette « conquête ».
Selon l’historien français Pierre Briant, les Perses, partageant avec les Mèdes des racines ethnolinguistiques communes (indo-iraniennes), intégrèrent leurs structures administratives. L’usage de l’élamite dans les archives achéménides, ainsi que la reprise de symboles royaux médiques, témoignent d’une transition négociée plutôt que d’une rupture brutale.
Toujours est-il que cette conjecture servit les Achéménides : Cyrus, libérateur vertueux, légitima son empire en contrastant avec la « tyrannie » mède. En réalité, son génie résida dans la synthèse des héritages. Les jardins de Persépolis, ouverts sur les paysages, et le temple d’Anahita à Kangavar, doté d’un système hydraulique innovant, incarnent cette fusion entre innovation perse et traditions locales – un équilibre que Jamshid, dans son arrogance, avait perdu.
Nomadisme et érudits voyageurs de Hamadan
Au carrefour des monts Zagros et des routes caravanières, Hamadan incarne l’esprit nomade du savoir. Parmi ses figures illustres, trois noms transcendent le temps : Ibn Sina, médecin-philosophe en quête d’universel ; Baba Taher Oryan, poète mystique aux vers brûlants ; et Mir Sayyid Ali Hamadani, soufi bâtisseur d’empires spirituels. Un vagabond lyrique, un penseur universel, un réformateur méconnu : leur nomadisme ne fut pas une fuite, mais une conquête du savoir nourrie par l’errance.
Ibn Sina (Avicenne) : l’esprit universel en exil
Au cœur de Hamadan, le mausolée d’Avicenne — structure de pierre ocre et de béton — abrite la tombe de ce génie persan. Sa tour dodécagonale symbolise les douze disciplines qu’il maîtrisait, de la médecine à la métaphysique. Enfant prodige à Boukhara, il fuit les guerres pour parfaire son art à Gurganj, Gorgan et Ray. Devenu médecin de cour à Hamadan, emprisonné pour ses idées, il rédige en secret Le Livre de la Guérison, fondement de la médecine médiévale.
Baba Taher Oryan : le vagabond lyrique
Sur une colline dominant Hamadan, le Jardin des Larmes abrite la dépouille de ce poète du Xe siècle. Ses quatrains, rédigés en dialecte luri, mêlent l’amour divin à la souffrance humaine. Né parmi les nomades Lors, il erra en haillons, dénonçant l’hypocrisie religieuse. Ses vers, tels que : « Mon cœur est brûlé, mon corps couvert de cendres / Toi, le vent, porte ma plainte jusqu’à l’aimé », traversent les siècles, toujours empreints d’une douloureuse ferveur.
Mir Sayyid Ali Hamadani : le soufi bâtisseur
Né à Hamadan en 1314, ce savant chiite voyagea durant trente-sept ans à travers l’Asie, fondant plus de sept cents monastères soufis. Son mausolée à Srinagar, orné de bois incrustés de motifs persans, symbolise la fusion du soufisme avec les spiritualités himalayennes, notamment le bouddhisme. Son traité, Zakhirat al-Muluk, lie gouvernance et mystique, laissant une empreinte durable sur la culture du Cachemire.
L’âme nomade de Hamadan
Hamadan, éclipsée par Ispahan mais berceau de civilisations, incarne une vérité tombée dans l’oubli : les empires naissent de la circulation des idées, non de la pierre. Ibn Sina, Baba Taher et Mir Sayyid Ali, par leurs errances, rappellent que la sagesse se cultive sur les chemins. Ils étaient des philosophes marchants. Aujourd’hui, tandis que les tentes noires des nomades s’effacent, leurs mausolées demeurent des phares pour ceux qui cherchent, dans le vent du Zagros, l’écho des quatrains de Baba Taher ou des traités d’Avicenne :
Depuis le jour où Tu m’as créé,
Tu n’as vu que péchés, et rien d’autres.
Ô Seigneur, par les Quatorze Immaculés,
Pardonne- moi : « Un chameau par ici ? Ni vu ni connu ! »